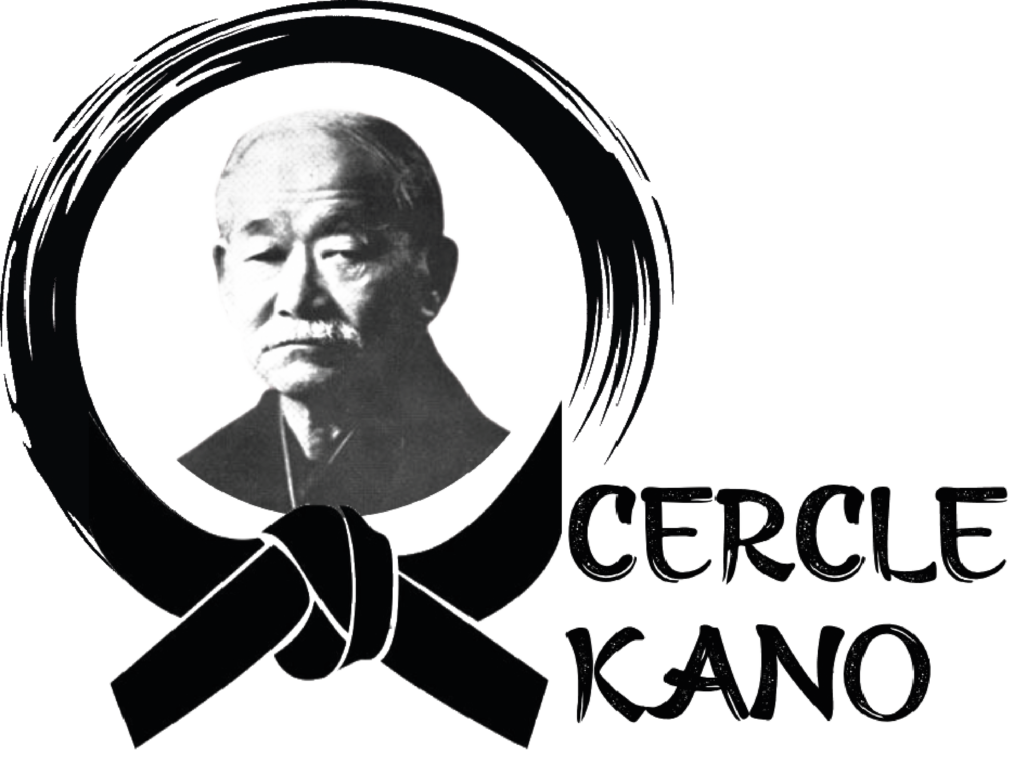CULTURE HERITAGE ET PARTAGE
PLURALITE DU JUDO
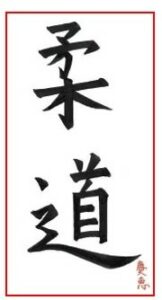
Le mot « judo » est composé de deux idéogrammes d’origine chinoise ou kanji : « ju » signifiant « souplesse et adaptation » et « do » signifiant « voie ». Le « judo » est donc littéralement « la voie de la souplesse et de l’adaptation » qu’elle soit physique ou mentale.
Le judo est certainement le plus célèbre des arts martiaux. Depuis la création de la méthode fondée par Jigoro KANO et l’enseignement de ses principes essentiels, le judo véhicule des idées de progrès tout en s’efforçant d’éveiller les consciences.
Nous pouvons donc penser que nous sommes devant le remarquable exemple d’une transmission descendant directement de la méthode originelle de son créateur. C’est en tout cas la revendication historique et symbolique la plus fréquemment citée.
La plupart du temps, nous offrons une image idéale de la ceinture noire, symbole de l’unité individuelle, nourrissant l’utopie « entraide et prospérité mutuelle » pour la faire vivre dans nos dojos avec pour ambition légitime de vouloir participer à l’amélioration de la société.
Cette idéologie existe bien et correspond à celle de la philosophie de Jigoro KANO que l’on peut qualifier d’humaniste.
En cela, à travers la découverte d’autres personnes, le partage du savoir, l’apport de nouvelles connaissances, nous apprenons à mieux nous connaître. Ainsi nous accumulons du vécu, des histoires, tout en partageant des moments forts de relations interactives.
Passer du temps ensemble nous aide à tisser du lien qui nous rend ainsi plus solidaires. Nous pouvons alors parler de l’éthique de la rencontre de l’autre.
L’idée que le judo n’est « pas que du sport » puisqu’il est « plus qu’un sport » a été largement relayée par l’Union Européenne de Judo (UEJ) qui l’a érigée en slogan.5
Cette affirmation « le judo, plus qu’un sport » que nous mettons en avant souvent au sein du collectif judo peut nous renvoyer à la subjectivité de chacun qui doit garder modestie et raison.
Avec raison, d’autres personnes comme l’historien Yves CADOT, s’appuient sur des formulations proches, comme « le judo plus que du sport ».6
Mais notre particularité tient au fait que notre discipline
a son fondateur, même si l’on peut nous rétorquer que de nombreux sports
peuvent prétendre à la même singularité. La différence doit donc se faire par les valeurs et principes universels de notre
discipline en opposition à la seule pratique sportive.
DE LA NECESSITE D’UN ENSEIGNEMENT AUX VALEURS EDUCATIVES DU JUDO
L’enseignement moral, en son principe est légitime.
C’est une vérité que l’on connait au moins depuis Emile DURKHEIM, un des fondateurs de la sociologie moderne (1858-1917) : toute société est intéressée à la formation de la jeunesse aux valeurs qui la constituent, parce que toute société a le souci vital de sa perpétuation et de son équilibre.
Notre institution ne fait évidemment pas exception à la règle.
Quant au programme de l’enseignement de nos valeurs au sein du Cercle Kano, il est maintenant conçu comme un projet conforme à ce que doit être une formation moderne. Mais comme nous l’avons déjà souligné, il faut prendre en compte la portée de l’ambiance culturelle sur l’individu dans le mouvement judo citoyen.
Nous estimons que les orientations de valeur et les attitudes éthiques ont un rôle de première importance au sein de notre pratique ou de notre discipline mais aussi parce qu’elles influent sur la vie sociale et la vie au sein d’une communauté à tous les niveaux du quotidien.
Dans un contexte sportif éducatif, distinguer ce qui est correct de ce qui ne l’est pas constitue un élément déterminant de la formation et de l’orientation du comportement du judoka.
L’apprentissage et la réussite de celui-ci dépendent aussi de sa culture, du système symbolique dans lequel il évolue.
C’est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement attentifs aux valeurs de notre Charte Ethique et à leurs évolutions, ainsi qu’à l’éthique de responsabilité également dans le cadre de notre transmission culturelle.
Elle insiste sur la dimension sensible de la vie éthique, en cherchant à développer les capacités d’empathie, de bienveillance et de souci des autres, sur le principe d’égale considération des personnes, mais également sur le rapport instituant, et non seulement subi, des règles.
Elle prend acte du fait et de la valeur de la pluralité des convictions et des modes de vie de chacun.
Notre transmission parie sur l’idée que c’est en mesurant leurs appréciations à celles des autres, dans des mises en situations, des échanges au sein du Cercle Kano que nos membres pourront construire du COMMUN et reconnaître la valeur de nos règles éthiques partagées par tous.
Enseignants, ceintures noires, hauts gradés, champions… tous les judokas sont des acteurs de la CULTURE. L’enseignant, qui a reçu cette culture de ses formateurs, diffuse à son tour le message culturel à ses élèves, et ce phénomène d’acculturation se continuera en boucle. La culture est inhérente au judo. Enseigner et pratiquer le judo ne peuvent se faire sans référence à la culture de l’activité.
LA CULTURE JUDO - L’AFFAIRE DE TOUS LES JUDOKAS
La transmission de la culture ne saurait se limiter aux enseignants, aux champions et aux hauts gradés. Tous les acteurs du judo, dirigeants, arbitres, juges, cadres techniques, ceintures noires… ont des savoirs, de l’enthousiasme, de la sagesse à partager. Plus globalement encore, tout judoka est acteur de la culture car pour transmettre le message culturel, il faut certes être un émetteur, mais encore aussi savoir être un récepteur !
Le judo se pratique entre deux partenaires. Le judoka tient compte de l’autre et s’adapte à la diversité de chacun. Il respecte l’esprit de l’exercice et peut ainsi progresser. A son tour, il deviendra partenaire pour aider l’autre à progresser.
Sport individuel, le judo prend donc tout son sens dans l’altérité et dans l’expression du collectif.
La relation « Tori/Uke » n’est pas duelle « Tori ou Uke », ni fusionnelle « Tori et Uke » mais fondée sur l’altérité « Tori/Uke » puisque chaque élément du couple est indifféremment l’une ou/et l’autre des deux composantes.
En ce sens, le judo est autant une activité d’opposition que de coopération puisqu’il y a nécessité à construire ensemble pour s’approprier chacun son tour les acquisitions techniques qui permettront de vaincre en combat. Transposée à l’échelle de la société, cette relation de soi aux autres, c’est l’alternance des confrontations d’idées et de l’incessante recherche du consensus à l’origine du pacte de société.7
C’est le message universel que Jigoro KANO nous a légué dans la formule selon laquelle « les hommes sont rivaux dans la compétition, mais unis et amis par leur idéal dans la pratique de leur sport et plus généralement dans la pratique de la vie ».
Jigoro KANO a qualifiée sa méthode « d’éducation physique, intellectuelle et morale »
De là, trois idées force peuvent apparaître dans sa démarche : « développer, cultiver l’esprit », « expérimenter, s’exercer au combat » « construire, façonner un corps ». Ce triptyque, cette combinaison peut être perçue comme un principe universel.
Il en résulte que la formation de l’homme ne peut se faire qu’en lien avec les autres, avec soi-même partageant avec l’autre, contribuant ainsi à l’amélioration de la société afin d’atteindre la prospérité mutuelle.
Nous voyons bien que dans cette quête de sens nous devons sans cesse continuer à peaufiner la construction de notre édifice personnel, notre dojo intérieur, en l’enrichissant progressivement des éléments qu’avec le temps nous avons affinés avec attention et humilité, et en nous appuyant sur notre soif de connaissance, de perfectionnement mais aussi d’excellence.
En tant que ceintures noires, nous avons été éduqués à savoir que cela demande des efforts incessants et une volonté chevillée au corps. Nous pouvons ainsi mesurer ce qu’il nous reste à parcourir et agir en conséquence.
Le judo n’apporte ni doctrine ni dogme. Il œuvre à rendre le judoka conscient de son humanité et de son aspiration à une harmonie plus grande, chacun attendant de se parfaire et de s’enrichir de la différence de l’autre.
[5] Judo – more than sport.
[6] Yves CADOT « Judo et sport » Revue « L’Esprit du judo » n° 67 d’avril-mai 2017.
[7] Jean-Jacques ROUSSEAU « Du contrat social » 1765.
[8] Eleanor ROOSEVELT (1884-1962).
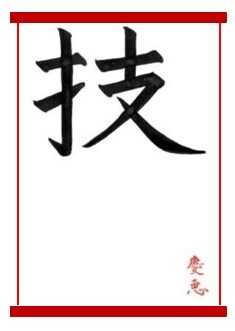
La pratique du judo s’extériorise par la technique qui est à la base de tous les apprentissages du judo. Plus important que l’acquisition ou la maîtrise du geste, il y a la démarche. Méthode d’éducation physique et mentale par la pratique, le judo est une expression de la diversité : art martial, finalité sportive, self-défense, vocation utilitaire, école de vie…
Technique
L’AVENIR A SA LÉGENDE
Aujourd’hui, le judo est devenu un sport très populaire dans le monde. Cela ne doit pas nous faire perdre de vue que Jigoro KANO avait résumé son dessein ainsi : « Le judo est l’élévation d’une simple technique à un principe de vie ».
On peut admettre que ce principe de portée générale englobe, en fait, toutes les activités humaines. Ainsi « Judo », dans le sens le plus large du terme, est une étude, un procédé d’entraînement applicable à l’esprit et au corps en ce qui concerne la direction de sa vie.
Son intention n’était-elle pas aussi de promouvoir un moyen d’éducation nouveau dont le principe était « la meilleure utilisation de l’énergie physique et mentale » ?
Le judo restant un tout comme l’avait si bien dépeint son fondateur « méthode d’éducation physique, intellectuelle et morale », aujourd’hui nous parlons de judo sportif et de judo éducatif ayant comme dénominateur commun un héritage culturel porteur des principes essentiels et indissociables qui guident sa pratique, que nous rappelons modestement par la Charte Éthique du Cercle Kano.
Pourtant, le judo a toujours intrinsèquement des aspects sanitaires, utilitaires (être en forme, savoir chuter, se défendre) et par nature éducatifs.
Depuis sa création, le judo a su garder la notion de combat dans le sens de l’affrontement noble, avec en filigrane le symbolisme de la défaite ou de la victoire – avec l’Ippon qui met un terme définitif au combat – qui rappelle la dualité de la vie et la complexité des relations humaines.
Nous faisons tous face à une appréhension, une inquiétude, au doute de nos capacités, mais nous savons que sans l’autre nous ne sommes rien.
Nous expérimentons notre corps dans l’exercice de toutes les applications des techniques du combat. N’est-ce pas une très belle mise en scène de la condition humaine ?
Voilà pourquoi le judo ne sera pas en danger d’être dénaturé.
Il se distingue des autres disciplines par des valeurs humaines particulières, une éthique unique de la rencontre de l’autre et enfin par un effort constant d’équilibre entre tradition et modernité, éducation et compétition.
La pratique sincère du judo, en s’efforçant d’en respecter les trois grands principes essentiels indissociables (l’adaptation, la meilleure utilisation de l’énergie, la prospérité mutuelle par l’union des forces) et les fondements, de les appliquer en toutes circonstances, modifie progressivement le comportement du judoka et le rapproche de l’éthique propre à cette discipline.
Les membres du Cercle Kano doivent être des garants des valeurs transmises car « hier est l’histoire, demain est le mystère, aujourd’hui est le cadeau, c’est pour cela qu’on l’appelle le présent ».8
Ce présent peut tout métamorphoser !