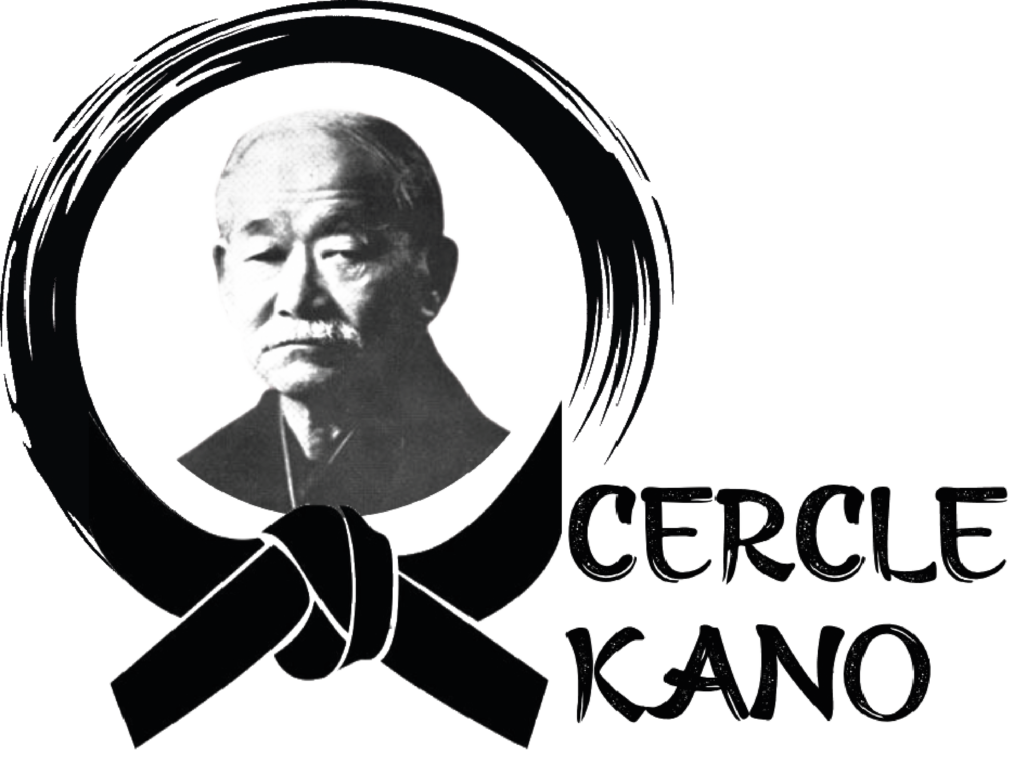CULTURE HERITAGE ET PARTAGE
RESSOURCES CULTURELLES
La pratique du judo nécessite un ensemble d’éléments essentiels et indissociables.
C’est d’abord un cadre contextuel formé du dojo, de l’enseignant et de son enseignement dispensé à l’intérieur du dojo.
Autant que le contenu même, c’est ensuite la méthode éducative par la pratique, qui dicte les comportements à travers des principes essentiels.
C’est encore l’omniprésence de la dimension culturelle dans tout ce qui touche à la pratique même du judo et à son environnement.
C’est enfin la transposition de cet ensemble bien au-delà de l’enceinte du dojo et de la stricte pratique du judo que nous tenons à fertiliser à l’intérieur du Cercle Kano.
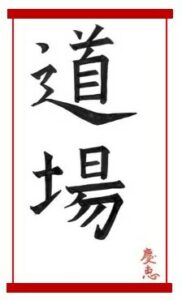
Comme « judo », le mot « dojo » est composé de deux sinogrammes : le kanji « do » signifie « voie » et le kanji « jo » signifie « lieu ». Le « dojo » est donc le lieu où l’on étudie la voie, celle de la souplesse et de l’adaptation ou « judo ».
LE DOJO : SON SENS SYMBOLIQUE
Lorsque nous pénétrons dans le dojo, nous entrons dans une autre dimension, une dimension dans laquelle les rapports qui se tissent, les aventures qui se vivent sont dictées par la « règle », la tradition, notre culture, d’une manière explicite ou implicite.
Cette façon d’être, cette conduite, ce comportement auxquels nous nous appliquons avec sérieux dépasse bien souvent ceux dont nous sommes capables au-dehors du dojo, dans la vie de tous les jours.
Car nous savons intuitivement que ce qui se passe dans ce lieu est unique, profondément riche d’enseignements. Nous y découvrons la victoire, mais aussi la défaite autant dans le succès au combat que dans la réussite d’une technique ou d’un exercice. Nous devons faire preuve de courage, dominer parfois la douleur, avoir une force d’âme.
Ces sentiments puissants et ces expériences importantes d’entraide et d’adversité, de progression, de frustrations ne sont possibles que dans cet espace unique que l’on peut qualifier de « sacré ».
Sacré sans le sens de « sacrum » séparé, séparé du monde extérieur.
Cet affrontement si essentiel à la nature de l’homme et cette façon particulière de nous exprimer dans la pratique du judo changent notre regard sur la vie.
Dans ce lieu, nous voici nourris d’aventures simples qui nous permettent d’aller à l’essentiel : s’éprouver, se rencontrer soi-même et rencontrer les autres à travers le jeu de la confrontation.
Mais c’est par l’expérience du dojo que l’on peut mesurer ce qui sépare le judo d’un sport, car au-delà de la passion de maîtriser et de progresser qui domine, son fondateur n’a-t-il pas mis en exergue qu’il était une méthode d’éducation physique, mais aussi intellectuelle et morale incarnant l’idéal judo ?
Mais attention, en fait le Dojo n’existe pas en soi, il peut prendre une autre forme si on veut le construire. Nous voulons dire par là, ce dojo intérieur qui est aussi le lieu de recherche de la voie et c’est sûrement le plus important.
Il n’est pas seulement formé de quatre murs et d’un toit abritant un tapis. Il est le symbole de notre équilibre et de notre verticalité, d’un destin partagé, d’un lien forgé par la même recherche de progression, une même volonté d’accéder à une plus grande maîtrise, et un soutien commun dans cette belle aventure qu’est le judo.
LES PRINCIPES ESSENTIELS DU JUDO
Trois principes essentiels et indissociables, distingués par Jigoro KANO, guident la pratique du judo. Le premier, souvent en retrait, est l’adaptation grâce à la souplesse ou « Ju no ri ». Le deuxième, imageant dans le grand public l’efficacité du judo, est l’utilisation de la force de l’adversaire ou « Zeiryoku Zenyo ». Le troisième s’exprime par entraide et prospérité mutuelle ou « JitaYuwa Kyoei ».
JU NO RI, L’ADAPTATION
Le premier est le principe de la non-résistance (ju). Ce principe est si étroitement lié à la discipline qu’il lui donne son nom : pratiquer le judo, c’est s’engager dans la voie (do) de l’application du principe de l’adaptation par la souplesse (ju).
Il invite à s’élever dans la pratique au-delà de l’opposition des forces musculaires, pour atteindre une véritable maîtrise des lois subtiles du mouvement, du rythme, de l’équilibre des forces.
Ju est une attitude : le faible s’adapte au fort pour le vaincre par la souplesse.
Transposé dans la vie quotidienne, c’est savoir se positionner avec pertinence dans le contexte, pouvoir adapter son comportement en fonction de ses interlocuteurs, plus globalement, agir en se mettant à la portée de l’autre.
SEIRYOKU ZENYO, LE MEILLEUR EMPLOI DE L’ENERGIE
Le second principe est la recherche du meilleur emploi de l’énergie physique et mentale. Englobant le premier principe et le dépassant, il suggère l’application à tout problème, de la solution la plus pertinente : agir juste, au bon moment, avec un parfait contrôle de l’énergie employée, utiliser la force et les intentions du partenaire contre lui- même. En judo comme en tout, il convient donc d’agir avec la meilleure utilisation de l’énergie.
La méthodologie d’action est identique en judo et hors judo : ne pas s’opposer frontalement mais contourner l’opposition, utiliser notre point fort contre un point faible de l’opposant, laisser son adversaire s’emporter dans la passion ou la déraison et agir en contre avec raison et discernement, reprendre des arguments pour les retourner contre son auteur, etc…
JITA YUWA KYOEI, LA PROSPERITE MUTUELLE PAR L’UNION DES FORCES
Le troisième principe est l’entente harmonieuse, la prospérité mutuelle par l’union de notre propre force à celle des autres. Découlant de la pratique sincère des deux premiers principes, il suggère que la présence du partenaire, du groupe, sont nécessaires et bénéfiques à la progression de chacun. En judo, les progrès individuels passent par l’entraide et les concessions mutuelles. C’est précisément cette entraide qui créera la prospérité mutuelle.
Aider Uke à progresser fera aussi progresser Tori, et cela se vérifiera encore lorsque Tori deviendra à son tour Uke. Chacun a alors à gagner dans cette mutualisation des efforts. La notion de « partenaire » prend alors tout son sens et nous invite à mesurer la relativité du concept de supériorité.
Appliqués à la technique du judo et à la gestion de l’activité, ces trois principes, qui s’interpénètrent, prennent réalité avec l’utilisation de la force de l’adversaire plutôt que l’opposition frontale, l’optimisation des ressources, la mutualisation des moyens, l’entraide comme source de bienfaits partagés.
Mais l’étude du principe judo et son application, dans son absolue généralité, au développement de la force intellectuelle et morale, à la vie en société, l’activité d’affaires, la manière de vivre, est plus importante que la stricte pratique du judo.[9]
Ces idées de Jigoro KANO se retrouvent aussi dans certains courants de pensée occidentaux. Ainsi, « céder sans cesse sur le secondaire pour rester fort sur l’essentiel » et « le maximum de rendement pour le minimum d’effort » 10 ont pu aussi constituer une philosophie de l’effort sportif en-dehors même du judo.
Plus connu du grand public que les principes d’adaptation par la souplesse Ju No Ri ou d’entraide et prospérité mutuelle JitaYuwa Kyoei, le principe d’utilisation de la force de l’adversaire Seiryoku Zenyo symbolise depuis l’origine l’efficacité du judo, comme à ses débuts en France lorsqu’on « murmurait que les initiés de haut rang pouvaient tuer un homme en poussant un cri mystérieux » : le kiai. (Alain Giraudo « Les tournants de la gloire-Anton GEESINK, l’honneur perdu de Soné » Le monde éditions 1992.
[9] Jigoro KANO « Discours sur l’éducation par le judo » 1932.
[10] Henry DE MONTHERLANT « Les Olympiques » 1924 « Le trouble dans le stade » Gallimard 1954.